
c a h i e r s d e l ' e s p a c e m é d i t er r a n é e n

|
|
|
|
|
|
|
|
|
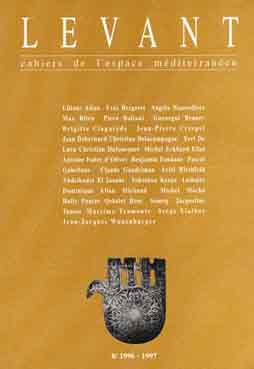 |
Max
Bilen
Dans un muméro récent du "Monde des Livres" consacré à la littérature européenne, l'écrivain Antonio Tabucchi se demandait d'où venait le fait qu'on s'interroge sur le dilemme de la vie et de l'écriture. Des poètes considèrent la vie comme littérature, d'autres la littérature comme vie, cependant que certains souffrent d'un sentiment de culpabilité pour avoir choisi entre vie et littérature... Ce problème du vécu et de l'écrit est devenu essentiel depuis que l'art a revendiqué son autonomie en se libérant de tout référent religieux, philosophique, et même de toute référence à la réalité en n'en accordant une qu'à celle de la créativité elle-même. Le philosophe Eliane Amado-Lévy-Valensi fait remarquer que le commandement essentiel du judaïsme est celui-ci: "J'ai mis devant toi le bien et le mal, la vie et la mort. Tu choisiras la vie afin que tu vives". L'ordre de vie, ajoute Lévy-Valensi, est peut-être ce qu'il y a de plus original dans le judaïsme. C'est la condition de l'Histoire". La nature de l'engagement de Jabès rend compte de sa conviction qu'il peut trouver dans l'écriture la justification de son être juif, qui procède de l'exigence de découvrir une identité entre la vie et l'art. Contrairement à ce que certains critiques affirment, ce n'est pas comme métaphore que Jabès utilise la condition judaïque au regard de la vocation créatrice, cette identification ayant sa source dans une double expérience vécue et dans les conditions les plus éprouvantes. Valéry reconnaît au poète une "dualité de prêtre" et oppose l'ordre ordinaire du monde à l'état extraordinaire de la créativité poétique, la vie pratique et "l'autre vie", la personne-sujet et le "pronom universel". Chez Bataille, le monde du Bien est celui de l'efficacité où domine le souci de la durée, cependant que le monde du Mal (celui de l'art) n'assure aucun profit, sinon le plaisir de l'instant marqué par la transgression des interdits. Pour Blanchot, par l'écriture, nous sommes arrachés aux modes de la temporalité. D'où l'opposition entre l'homme mesuré, vivant dans le monde commun des paroles quotidiennes, et l'artiste vivant dans un espace infini, qui refuse d'être quelqu'un pour les autres et quelque chose pour soi-même. |
| Or le poète Jabès ne pouvait vivre les valeurs éthiques
du Monde du Bien, auxquelles il croyait et ne pouvait les savoir encore
vivantes, universelles et intemporelles, que dans l'espace de l'écriture,
c'est à dire dans le monde du Mal, en retrouvant en elles, surtout,
la ferveur qui pouvait suppléer à sa foi religieuse absente.
La dichotomie vie-écriture est à la source du sentiment de culpabilité de Kafka: la littérature ne pouvait se justifier comme activité, elle ne pouvait que s'opposer à la vie car elle exigeait le sacrifice de celle-ci, ce qui est contraire à la pensée juive. Pour Proust, également d'origine juive, le dilemme ne se posait pas puisque l'entrée en écriture, selon lui, ouvrait au surnaturel, au domaine de l'art qui permet d'accéder à la permanence et à l'universalité, en dégageant les secrets qui sont contenus dans les choses de la vie. Le texte que le poète tire de la réalité lui permet d'accéder à une vie seconde ("la vraie vie"). La fonction de l'art est de "composer exactement la vie" dans sa vérité. C'est ainsi que la vie se réalise dans et par la littérature, l'oeuvre véritable est le récit de cette révélation, que nous tirons de nous-mêmes. La vision de Jabès procède, à la fois, du dilemme de Kafka et de l'identification établie par Proust. L'unité réalisée entre condition humaine et vocation créatrice est garante de libération, de rédemption et de salut. En un temps déchiré oùla conjuration contre le Juif était quasi-unanime, la condition humaine ne pouvait pas être autre chose, par solidarité, par dignité ou par désespoir, que l'acceptation de l'identité juive, par laquelle se vivaient quotidiennement les épreuves de l'exil, de l'étrangeté, du risque et du défi et même l'expérience des limites, épreuves reconnues à la créativité artistique. Et cela non point dans l'imaginaire mais dans une réalité dépassant tout ce que la fiction avait pu suggérer d'horreur et d'arbitraire. Le temps n'était plus celui de l'écriture doublant la réalité ou la dépassant, mais celui où certains portaient sur eux l'étoile jaune de leur destin... Selon Jabès, l'auteur est, certes, absent du livre, comme Dieu est absent de l'univers, le livre est le désert, pays à la fois du Juif et de l'écrivain, espace absolu, infini, inachevé, irréductible, en suspens, espace du néant, du gouffre, de l'absence, du vide, de la mort, mais ce n'est qu'en évoquant les images de sang, d'eau mêlée à la flamme, de cendre, d'ombre et de silence que le judaïsme du temps du malheur peut s'identifier, pour Jabès, à l'écriture. Et cela, parce que le judaïsme se vit aussi tragiquement et avec la même plénitude que l'écriture. A ce niveau de vérité assumée aussi bien dans une
condition que dans l'autre, on ne saurait parler de figure de rhétorique.
En ces moments limites, l'écriture ne vient pas au secours de la
vie, mais se confond avec elle parce qu'elle y trouve son climat de permanence
et de communion. Alors, la vie, morcelée, ayant perdu toute cohésion,
devient fragmentaire dans l'écriture, tandis que dans l'écriture,
l'errance, la rupture, la nostalgie de l'unité perdue se lisent
comme dans la réalité.
|
Retour